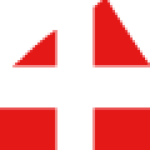Caprices du ciel vers 1750 : pluie, neige, grêle, gelée

Explorer les archives des XVIIIème et XIXème siècles procure bien des surprises En voici quelques-unes concernant des évènements ou des personnalités plus ou moins connues.
Tout comme le siècle qui l’a précédé, le XVIIIème siècle connait une succession de catastrophes climatiques dont les manifestations ont laissé de nombreuses traces dans les archives.
C’est le cas pour les fortes chutes de neige qui recouvrent le Chablais à la mi-juin 1771. Un témoin rapporte que les vaches qui venaient juste de monter à l’alpage avaient les cornes qui «apparaissaient à peine au-dessus de cette haute couche». On apprend qu’ensuite l’hiver qui suivit cette triste saison fut cruel. Ce genre d’épisode extrême est récurent durant cette période appelée «petit âge de glace» caractérisée par une série d’hivers longs et froids et par une avancée générale des glaciers dans les Alpes. De surcroit, précise l’historien Roger Devos, les hommes sont confrontés à «une série de perturbations atmosphériques aux conséquences graves pour une économie de subsistance : gelées tardives ou précoces compromettant les semis ou la récolte, chutes de neige abondantes, pluies excessives en plaine provoquant des inondations, orages de grêles l’été hachant les blés et les vignes». Les archives dévoilent aussi des sécheresses profondes et durables entraînant comme les autres calamités famines et épidémies.
C’est un orage de juillet, accompagné de chutes de grêle dévastatrices qui touche la commune d’Albens à l’été 1785. La catastrophe est telle que, dans une adresse à l’intendant de Savoie, la communauté s’empresse de raconter que «le jour d’hier sur les six heures du soir la paroisse a été affligée d’une affreuse intempérie, qui a anéanti tous les fruits qui restaient à récolter, ce qui annonce une misère prochaine». Elle demande ensuite qu’une enquête soit menée afin d’évaluer les dégâts occasionnés par l’averse de grêle. A travers tous les témoignages et documents qu’elle génère, nous sommes d’abord projetés au cœur de l’orage.
[[{"fid":"36612","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":312,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
La mappe sarde d’Albens réalisée en 1729.
Voici ce que raconte un des deux témoins questionnés : «je moissonnais près du village de Lépau de cette paroisse, pour François Buttin fermier…Sur environ les cinq heures et demi du soir j’ai vu parroitre quantité d’éclairs, j’ai entendu gronder le tonnerre, et sur les six heures j’ai vu dans les airs quantité de nuées noires et blanches, qui depuis la montagne de Cessens et Saint-Germain prirent leur direction sur cette paroisse, où elles s’étendirent… et aussitôt j’ai vu arriver une affreuse intempérie composée d’une grosse et abondante grêle qui tomba pendant l’espace d’un quart d’heure, que je restai à couvert chez le dit Buttin, d’où étant sorti, je vis qu’il était tombé deux pouces et demi de grêle, qui avait endommagé considérablement les arbres et les blés des environs». L’autre description est assez semblable, précise l’historienne Isabelle Gonard qui a relaté cette catastrophe dans le numéro 6 de la revue Kronos. Elle nous livre aussi de larges extraits du rapport des experts à propos des dégâts avec cette conclusion : «la récolte de la communauté d’Albens en froment, orge, avoine, légume, vin, chaumes et fruits de toute espèce a été réduite par le fait de l’intempérie arrivée le 22 du courant dans toute l’étendue d’icelle à moitié au moins…». Albens n’est qu’une des communes touchées par de tels orages qui éclatent alors du Faucigny jusqu’à la Savoie méridionale. Dans «La Savoie au XVIIIème siècle», l’historien Jean Nicolas rapporte qu’en 1781 «les paroisses situées le long de la montagne d’Epine sont bombardées de grêlons gigantesques, hérissés de pointes aigues qui hachent les blés noirs et détruisent au trois quart les vendanges».
Les chutes de neige occasionnent à leur tour d’importants dégâts aux cultures et de plus entravent les déplacements. Ainsi au mois de janvier 1758 où «l’abondance des neiges a arrêté la circulation sur la route d’Annecy à Genève et sur la route des Echelles à la Grotte». De telles intempéries se répètent longtemps comme le rapporte M. Mougin dans son ouvrage «Etudes glaciologiques en Savoie». Voici ce qu’il relate à propos du rude hiver 1809-1810 : «Au mois de février, la circulation fut interrompue et, le 22, l’autorité administrative dut inviter les maires à faire déblayer la route impériale de Chambéry à Annecy. Des voyageurs mirent trois jours pour se rendre de Bonneville à Annecy, et les courriers ne purent voyager qu’à cheval».
Quand ce n’est pas la neige, c’est le gel qui vient perturber l’ordre des saisons. C’est ce que raconte un médecin de Rumilly à propos des gelées précoces de l’automne 1770 qui ravagent le vignoble de l’Albanais et obligent que «l’on vendange à force pour faire du verjus», un jus acide extrait des raisins n’ayant pas mûri. Que dire des pluies continuelles qui font écrire au curé Fontaine d’Albens : «qu’il ne se passe pas un jour qu’il ne tombe quelques sacs d’eau». Une expression que l’on retrouve sous de nombreuses plumes à la fin du XVIIIème siècle.
[[{"fid":"36613","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":262,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
Notre-Dame de l’Aumône.
Devant toutes ces calamités, les populations en appellent à la religion pour implorer la clémence du ciel. C’est ce qu’a relevé l’historien Croisollet dans les annales des religieuses de la Visitation de Rumilly à propos de la réaction des habitants face à la sécheresse de 1719. Il relate ainsi la situation : «Les blés sèchent sur plante et on est menacé d’une famine générale. Le peuple et le clergé sont dans la consternation. Tous les curés d’alentour amènent leurs paroissiens en procession à Notre-Dame de l’Aumône, entre autres ceux de Hauteville et de Vallière. Le 6 juin, ceux de Saint-Germain, Cessens et Massingy, à la tête de leurs paroissiens viennent directement en procession à l’église de la Visitation de cette ville pour implorer l’assistance de Saint François de Sales». Outre les processions, le recours aux cloches de l’église est attesté dans une lettre du curé Fontaine d’Albens s’adressant en 1764 à l’intendant : «C’est la coutume dans le pays de sonner les cloches pour écarter les nuées qui menacent la tempête». De 1783 à 1784, une grande partie de l’Europe connaît une succession d’orages violents et souvent grêligènes. Les populations sont loin d’imaginer que les nombreuses brumes qui trainent dans le ciel comme des fumées sont en réalité des amas de poussières volcaniques crachées par le Laki depuis l’Islande et que ces mêmes amas favorisent les formations orageuses. Comme autrefois, les puissants moteurs de la nature continuent de nous impacter. Mais sommes-nous moins ignorants que nos ancêtres ?