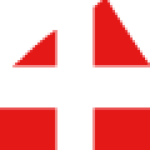La problématique de l’eau

La canicule de 2003 a marqué les esprits de toute une génération. Entrainant une première grosse sécheresse dans le bassin versant du lac du Bourget, elle sera pourtant suivie d’une dizaine d’autres épisodes de manque d’eau dans les années postérieures.
C’est pourquoi le CISALB (Comité Intercommunautaire pour l'Assainissement du Lac du Bourget), les agglomérations et les agriculteurs ont commencé à réfléchir ensemble à trouver des solutions et aussi à la manière dont il va falloir adapter les consommations en eau.
En effet, avec le changement climatique les épisodes de sécheresse sont désormais plus nombreux mais aussi plus longs. En plus, ils se décalent dans l’année, se prolongeant jusque tard dans la saison. On a par exemple pu voir celui de 2019 se dérouler jusqu’à mi-octobre et en 2018, c’était jusqu’à novembre. Au premier abord, on pourrait se dire que ce n’est pas un problème vu que le lac permet d’avoir des réserves d’eau largement suffisantes pour fournir la population. Et pourtant, ces épisodes de sécheresse ont un impact dramatique sur l’environnement : moins de pluie signifie que les débits d’eau sont en baisse constante dans les différents ruisseaux et sources. Ces derniers s’assèchent donc, mettant en péril les milieux aquatiques qui en dépendent.
Les déficits : une raison mixte
Vu que ces débits sont réduits à cause de sécheresses, on pourrait penser que ce n’est pas directement la faute de l’activité humaine. Pourtant, dans le cadre du SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), une étude de diagnostic du bassin versant du lac du Bourget a dû être lancée pour déterminer l’origine de ces déficits.
Le SDAGE est un ensemble de directives qui doivent permettre d’atteindre des objectifs en ce qui concerne l’état des eaux. Il y a 7 bassins en métropole, le lac du Bourget fait partie du bassin Rhône-Méditerranée. Si on veut schématiser, le bassin forme un triangle dont la base est la Méditerranée et le sommet se situe au sud de l’Alsace.
Ce qui est sorti de ces analyses, c’est que les déficits en eau ont une origine mixte. Il y a donc, dans un contexte climatique changeant, naturellement moins d’eau puisque les précipitations manquent en été mais les usages humains renforcent eux aussi cette sécheresse.
Au premier abord, les regards se dirigeraient vers les agriculteurs, qui pourraient être considérés comme de grands consommateurs d’eau. Et pourtant, la carte des secteurs dits problématiques montre que ce n’est pas le cas. Il ne faut pas se leurrer, si l’agriculture a un impact, il est essentiellement dû au fait que la consommation d’eau est concentrée sur quatre ou cinq mois dans l’année, période où la disponibilité de l’eau est moindre. Florent Bérard, technicien eau au CISALB nous a expliqué que si la consommation agricole n’était pas si concentrée, elle est suffisamment faible en proportion pour être invisible si elle est annualisée. La pression liée aux prélèvements pour l’eau potable reste la plus forte sur l’ensemble du bassin versant.
Des solutions existent
Une fois l’étude terminée, un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) a été mis en place sur le bassin versant du lac du Bourget, à partir de 2016, avec pour objectif de retrouver un équilibre entre les ressources, les usages et les besoins des milieux aquatiques. Autrement dit, il s’agit d’optimiser l’ensemble des consommations et de lutter contre les gaspillages. On notera d’ailleurs que les rendements des communes sur leurs réseaux d’eau potable, bien que disparates, sont considérés comme bon pour les grandes villes, autour de 75-80%. La lutte contre les fuites reste un enjeu majeur du Plan de Gestion de la Ressource en Eau. Selon M. Girel (responsable du pôle), la mutualisation des réseaux - due au transfert de compétence vers les agglomérations - participe à les améliorer puisque les capacités d’investissement se sont vu augmenter.
Pour autant, des actions spécifiques sont mises en place pour correspondre à chaque usage. En ce qui concerne l’eau potable, un travail est fait sur les captages. Sur les secteurs habituellement alimentés en eau potable par le captage de sources, l’eau est maintenant cherchée depuis le lac ou la nappe de Chambéry, (substitution par des ressources «pérennes» moins exposées au risque sécheresse). Outre le gain pour les cours d’eau, cela permet de sécuriser l’approvisionnement en eau de certains hameaux, alors que des tensions pouvaient apparaitre en période de sécheresse. Bien entendu, des investissements ont été nécessaires mais les agglomérations ont fait le nécessaire, à hauteur de 4M€ pour Grand Chambéry et 7M€ pour Grand Lac avec des aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.
En ce qui concerne l’agriculture, un travail est fait afin de pouvoir sécuriser les productions tout en retirant les pompages en cours d’eau ou les prélèvements dans les sources. Il existe donc trois grands projets de retenues colinéaires à usage collectif qui sont le fruit de 10 ans d’études et de discussions. Une d’entre elles est déjà en place à La Motte Servolex, elle permet d’irriguer 7,5 hectares répartis en trois exploitations en maraichage et arboriculture et représente 12 000m³ d’eau. Elle remplace donc les prélèvements en stockant tout simplement l’eau de pluie en période hivernale. Cela permet donc d’étaler les besoins en récupérant cette eau en particulier à des périodes où elle est abondante. M. Bérard nous a d’ailleurs dit avoir été satisfait du remplissage et du fonctionnement pour cette première année de mise en service. Des projets similaires à l’échelle individuelle sont également en cours. Il relève par ailleurs que la profession agricole fait de gros efforts afin de pouvoir optimiser sa consommation : investissements dans du matériel d’irrigation économe en eau (goutte-à-goutte, micro-aspersion), pilotage automatique de l’arrosage, changement de pratiques culturales...
Comment se présente l’avenir ?
La moyenne de pluie dans le bassin versant du lac du Bourget est d’environ 1200mm par an. La bonne nouvelle est que c’est un chiffre qui devrait peu varier d’après les estimations qui ont été faites. La moins bonne est que ces pluies vont être encore moins bien réparties dans l’année. On le constate d’ailleurs depuis maintenant quelques années puisque cela fait maintenant six ans qu’il y a chaque été un arrêté d’alerte sécheresse. Il y a en plus eu en 2018, pour la première fois, un niveau de crise. Dans l’autre sens, de gros volumes d’eau tombent sur des périodes réduites. Le but sera donc de stocker ces volumes qui tombent au même moment sur le modèle des retenues qui sont déjà en construction et de les utiliser pour faire face aux sécheresses. Mais en plus de ça, il est impératif d’optimiser les réseaux afin d’éviter les pertes.
Il y a toutefois d’autres bonnes nouvelles. Tout d’abord, les PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) montrent que la situation devrait être sous un contrôle relatif au moins jusqu’à 2040.. Cela s’ajoute au fait que les services de l’État sont maintenant très stricts puisqu’une autorisation d’urbaniser un territoire passe par la justification de la présence d’une ressource considérée comme pérenne.
Enfin, il existe une nappe phréatique en Chautagne, dont le grand potentiel est aujourd’hui étudié pour l’alimentation future en eau potable.