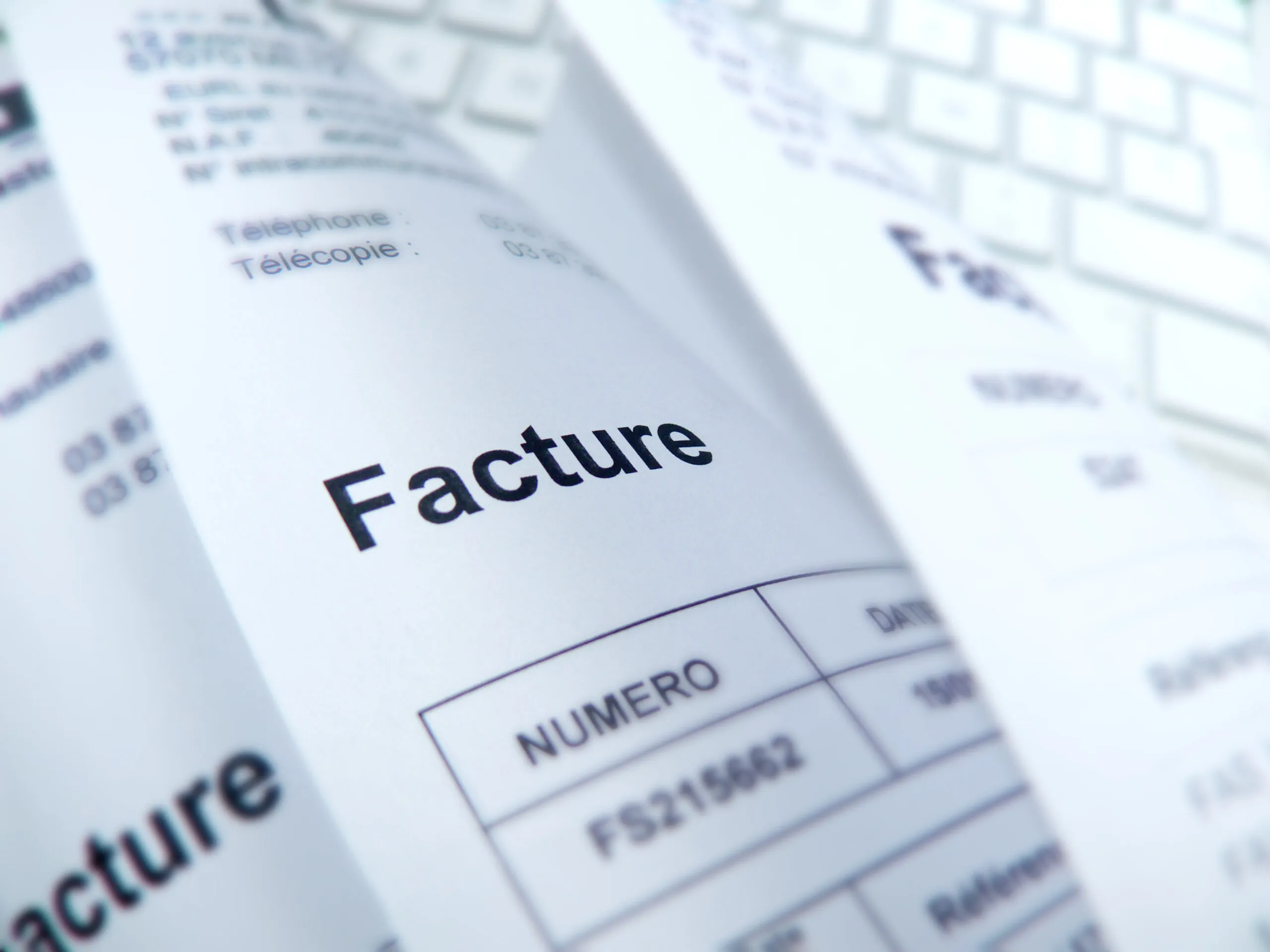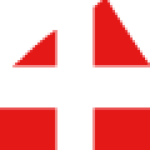Le Mont-Blanc mesure…

Une mesure effectuée entre le 16 et le 18 septembre dernier confirme la baisse d’altitude du toit de l’Europe.
Depuis 20 ans, tous les 2 ans, la Chambre Départementale des Géomètres Experts de Haute-Savoie organise une expédition composée de géomètres-experts, guides, partenaires et photographe afin de déterminer la hauteur du Mont-Blanc et modéliser sa calotte glaciaire. Ces relevés permettent d’alimenter une banque de données destinée à être exploitée par divers experts, glaciologues, climatologues et autres scientifiques, qui pourra être transmise aux générations futures.
Depuis 2007, année de son record où il culminait à 4810,90 mètres, le Mont-Blanc rapetisse. Son altitude la plus basse date de 2019 où une hauteur de 4806,03 avait été relevée. Depuis la première mesure effectuée en 2001, des variations de près de 5 m ont été constatées et une chute de 3m depuis 2011. A ce jour, le réchauffement climatique ne semble pas être mis en cause.
Pourquoi le sommet
du Mont-Blanc bouge-t-il ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Mont-Blanc change d’altitude. Quelles en sont les raisons ? Contrairement à d’autres montagnes, sa particularité est d’avoir un glacier à son sommet : une calotte glaciaire située sur un rocher culminant à 4792 m. De par son poids, le glacier a tendance à descendre mais il peut également monter, en fonction des précipitations et de la quantité de neige qui le recouvre. S’il y a peu de vent, la neige a le temps de se figer et se transforme ainsi en glace, élevant le sommet ; à l’inverse, en cas de fortes rafales, fréquentes à cet endroit, la neige est balayée et par conséquent le sommet ne grandit pas. L’altitude réelle est donc mesurée sur la partie supérieure du glacier, une fois la neige «soufflée».
Le réchauffement climatique n’a pour l’instant aucune incidence sur cette fonte car à une telle altitude, les températures restent négatives, mais rien n’exclut que cela puisse évoluer dans les prochaines décennies. En revanche, la baisse de la température mesurée au cœur du glacier, où un thermomètre a été placé par une équipe de glaciologues, pose question. Depuis 1994, elle est passée de -11 à -9 degrés.
Depuis 2015, où le sommet est mesuré 2 fois par an, au printemps et à l’automne pour étudier de possibles variations au cours d’une même année, l’attitude du Mont-Blanc varie d’1 ou 2 m entre le mois de mai et le mois de septembre. Ainsi, les experts se sont rendu compte que le toit de l’Europe grandissait durant l’été ; et non l’inverse. Cela peut paraître surprenant mais les météorologues ont fourni une explication : en hiver, il y a tellement de vent au sommet que la neige est poudreuse et donc facilement balayée alors que l’été, les rafales étant moins importantes, elle a tendance à se figer sur le glacier.
L’intérêt de ces mesures
Cédric Vialet, président de la Chambre Départementale des Géomètres-Experts de la Haute-Savoie explique que «au niveau de l’organisation départementale, ils avaient la volonté de mettre en place une action «phare», pour, entre autres, une meilleure connaissance environnementale, l’objectif étant de cumuler des données géographiques fiables, précises, sur une durée suffisamment longue pour réussir à savoir si cette tendance à la baisse se confirme ou pas, et pouvoir observer l’évolution du volume de glace, de l’altitude du sommet du Mont-Blanc afin de constater ou non une décroissance sur du long terme».
Comment le Mont-Blanc se mesure-t-il ?
Des mesures GPS précises permettre d’évaluer la hauteur d’une montagne avec une précision de deux à cinq centimètres. Teria, société fondée par l’Ordre des Géomètres, a posé 240 stations permanentes qui permettent d’effectuer des mesures de précision, malgré les variations de l’atmosphère séparant le satellite et la Terre. En fonction du climat atmosphérique, la trajectoire de l’onde peut être légèrement modifiée.
La mesure, qui pourrait être effectuée de façon annuelle, est planifiée tous les 2 ans, pour une question d’organisation. En effet, il s’agit une grosse expédition nécessitant environ 10h d’ascension sur 2500 m de dénivelés avec le transport d’un matériel conséquent porté à dos d’hommes (près de 10kg cette année). Le calcul de l’altitude est estimé à 30 min, celui des dimensions de la calotte glaciaire à 2h environ.
Lors de la récente expédition, les experts sont restés 3 heures au sommet pour relever la calotte sommitale dans ses moindres recoins, ce qui leur a permis d’atteindre un niveau de précision jamais réalisé jusqu’alors.
[[{"fid":"32028","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":618,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
L’expédition 2021 s’est déroulée dans d’excellentes conditions météorologiques. © Pascal Tournaire
Une aventure humaine
et une action
pour l’environnement
Cedric Vialet précise que «cette expédition est rendue possible grâce à l’engagement bénévole de confrères du département, qui ont su fédérer autour d’eux une équipe de partenaires et de professionnels aguerris». Tous ces passionnés partent à la conquête du sommet, à pied, afin de réaliser leur mission mais également pour défendre les valeurs de la profession des géomètres-experts : confraternité, dépassement de soi, médiation et prévention des conflits
Depuis 20 ans, les géomètres-experts privilégient la voie terrestre pour monter le matériel de mesure et les équipes, leur approche étant «définitivement durable et animée par une passion d’une montagne qu’il est nécessaire de préserver».
«Mont-Blanc,
mesures d’un mythe»
Pour célébrer les 20 ans de l’expédition, les géomètres-experts ont travaillé sur l’édition d’un livre dans lequel ils reviennent sur ces deux décennies de mesures. Ils y évoquent le défi humain, sportif, technologique et environnemental que cela représente et partagent les connaissances scientifiques apportées par ces mesures.
Ce livre évènement sera disponible fin octobre-début novembre et est déjà disponible en pré-commande. Plus d’informations sur le site 4810.eu.
Pour info :
La mesure des cousins Vallot, réalisée à partir de 1892 et officialisée en 1894, indiquait une altitude de 4807,2 m, apprise par de nombreuses générations d’écoliers. Elle ne sera remise en question qu’à la fin du XXème siècle.
[[{"fid":"32027","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":348,"width":700,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
Evolution 2001-2021 de l’altitude du Mont-Blanc relevée par les Géomètres-Experts
de Haute-Savoie. (DR)