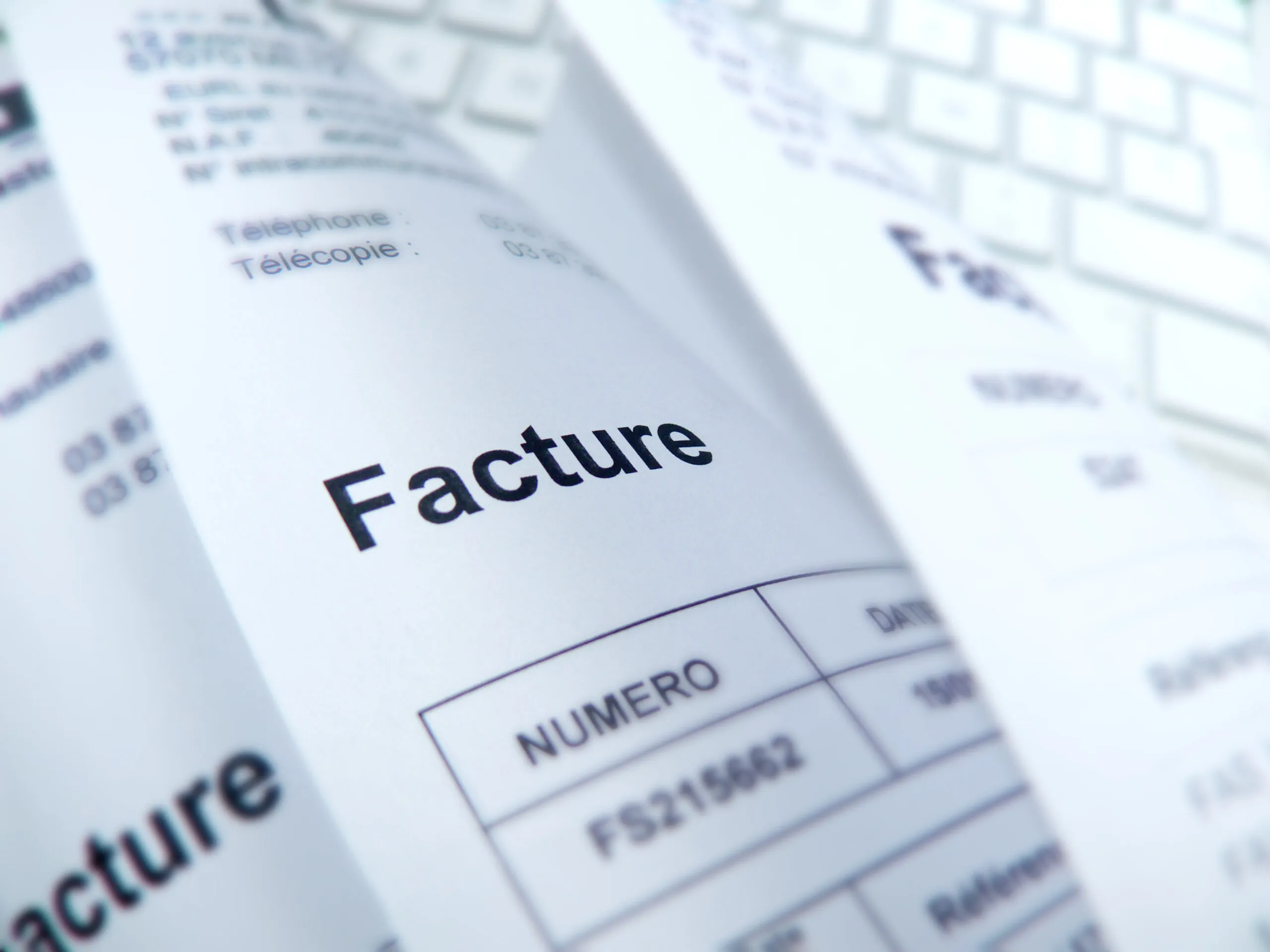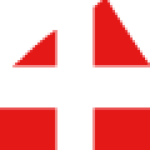Le PGHM : gendarmes et montagnards à la fois

Le secours en montagne a toujours existé dès lors qu’elle a été fréquentée., quand les chasseurs, cristalliers ou autres passeurs se sont organisés entre eux. Avec la naissance de l’alpinisme au 19ème siècle (à visée scientifique au départ puis de conquête avec l’âge d’or), diverses sociétés de secours se forment, constituées de volontaires.
L’hiver 1956, élément déclencheur
À l’hiver 1956-1957, un drame survient. Deux jeunes de 22 et 24 ans entament l’ascension du Mont-Blanc en dépit des mises en gardes de la part des locaux. Les deux jeunes, dont l’un était aspirant guide, se retrouvent bloqués sur le Grand Plateau, à 4000 m d’altitude, visible depuis Chamonix. Pendant plus d’une semaine, les habitants pourront donc suivre à la jumelle les péripéties des opérations de secours.
Celles-ci auront mis du temps à démarrer, un hélicoptère s’écrasera et les équipes de secours ne pourront pas récupérer les deux jeunes, intransportables.
Face à la polémique née du manque d’organisation ou de coordination des secours, l’État va alors décider de prendre à sa charge l’organisation du secours en montagne. En 1958, le premier Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) nait à Chamonix. D’autres suivront, en parallèle des CRS Montagne et des sapeurs-pompiers qui intègreront leur place dans les années 90.
Aujourd’hui, alors que 30% du territoire national est en zone montagne, il existe 21 PGHM et PGM en France.
Quelle organisation ?
Le secours en montagne est régi par un plan départemental de secours en montagne (PDSM), qui est lui-même dirigé par le Préfet. Ce plan détermine les endroits où les opérations relèvent du secours en montagne. Par exemple, en Savoie, il a fallu déterminer l’endroit où s’arrêtent les domaines skiables. En effet, sur ceux-ci ce sont les pisteurs qui effectuent les opérations.
Il faut ensuite cibler les acteurs qui œuvrent sur chaque massif. Toujours en Savoie, les sapeurs-pompiers s’occupent des Bauges et du nord de la Chartreuse tandis que la Police et la Gendarmerie alternent une semaine sur deux sur les autres massifs (Arrondissements d’Albertville et Saint Jean de Maurienne).
Le PGHM savoyard est basé à Bourg-Saint-Maurice mais possède une antenne à Modane. C’est d’ailleurs là que se situe l’hélicoptère à l’année. En saison hivernale, un autre poste est ouvert Courchevel et un hélicoptère du Service Aérien Français est utilisé en renfort. L’été, toujours à Courchevel, un hélicoptère de la sécurité civile se met également en place.
Des médecins urgentistes de Saint-Jean-de-Maurienne, Bourg-Saint-Maurice, Moûtiers et Albertville sont de permanence pour aider les gendarmes.
Cette organisation permet au PGHM de la Savoie de réaliser entre 750 et 800 interventions par an.
Une spécificité : trois rôles
Les gendarmes du PGHM sont connus pour leurs opérations de secours en montagne mais ce n’est pas leur seul rôle. En effet, le chef d’escadron Patrice Ribes, à la tête du PGHM de la Savoie explique que ses hommes ont trois casquettes : montagnard, enquêteur et secouriste.
Ceci s’explique par le fait que c’est une unité qui poursuit les missions de la Gendarmerie là où les brigadiers normaux ne peuvent pas aller. Par exemple, en leur qualité d’officier de police judiciaires, les militaires du PGHM vont ouvrir une enquête aussitôt après avoir porté secours à la victime. Ce rôle est essentiel puisque d’autres enquêteurs auraient plus de difficultés à accéder à certains lieux.
Qui compose le PGHM ?
Les hommes du PGHM sont structurés au sein de la Gendarmerie, en spécialité montagne. 100 000 personnes composent la Gendarmerie,
5 000 sont en zone montagne et seulement 250 sont membres d’un PGHM. En Savoie, 19 sont à Bourg-Saint-Maurice et 14 à Modane.
Dans toute la France, il n’y a que 4 femmes qui sont en spécialité montagne en gendarmerie.
Le Chef d’escadron Ribes l’explique d’abord par la proportion des femmes dans la Gendarmerie Nationale (environ 20%) et chez les Guides de Haute Montagne (moins de 5%). Il est donc encore plus difficile de trouver des femmes cumulant les trois fonctions recherchées par le PGHM.
Comment entrer au PGHM ?
Tout d’abord il faut être gendarme. Ensuite deux portes sont possibles pour entrer au PGHM. Pour les militaires qui ne sont pas guides ou aspirant guide à l’issue de leur scolarité de sous officier et après avoir été détectés par le CNISAG (Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie), les gendarmes sont affectés dans des unités de gendarmerie départementale ou de gendarmerie mobile dans des secteurs de montagne et entament leur formation montagne gendarmerie. À l’issue de cette formation ils peuvent passer les tests de sélection pour entrer en PGHM.
La seconde est de pouvoir intégrer directement un PGHM dès la sortie d’école de sous officier à condition d’être titulaire du diplôme de guide de haute montagne ou à minima d’aspirant guide.
Ensuite dans ces deux cas les personnels passent sur deux années la formation du brevet de secouriste en montagne.
Cette formation permet aux futurs membres du PGHM de se former aux pratiques particulières du secours en montagne. Comme les équipages sont réduits, le Gendarme doit savoir effectuer des manœuvres avec moins d’aide et porter assistance au médecin sur place. Il leur est aussi enseigné la règlementation spécifique à la montagne.
Une fois ces deux ans de formation validés, il est possible de rester au PGHM.
Toutefois, il reste possible de continuer à suive des formations tout au long de la carrière pour prendre des responsabilités. Ainsi, le Chef d’escadron Ribes estime à une dizaine d’année la durée de formation complète.
En moyenne, 15 candidats sont recrutés chaque année. Toutefois, s’il y a plus de places disponibles que de candidats, le niveau exigé ne sera jamais abaissé.
Les personnes recherchées doivent être aptes physiquement mais aussi et surtout avoir un excellent état d’esprit. Il est attendu des candidats d’avoir l’esprit d’équipe, d’être résistants et résilients.
Un laboratoire de recherche
Le PGHM sert aussi de laboratoire à la Gendarmerie et aux services de secours. Les conditions particulières dans lesquelles les militaires doivent œuvrer favorisent en effet la rencontre de problématiques inconnues.
Ainsi, un travail de recherche est constamment effectué pour trouver des solutions dans le cadre de la recherche des victimes.
Le Maréchal des logis-chef Rémi explique ainsi que les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées pour retrouver les victimes.
Des solutions ont été trouvées en utilisant de plus en plus les fonctions de GPS des téléphones mobiles par exemple. Il existe aussi un système qui permet de capter les ondes GSM de portables ensevelis sous la neige, ce qui permettrait de retrouver leur propriétaire.
Le chien, meilleur ami de l’homme
Symbole de la recherche de victimes ensevelies, le chien est évidemment utilisé par les gendarmes de haute montagne.
À Bourg-Saint-Maurice, c’est le gendarme David et Rooky, son berger belge malinois, sortis de formation en janvier, qui s’en chargent.
Cette formation en deux temps dure 17 semaines. La première partie fait 14 semaines et le duo apprend à suivre des pistes, et la seconde dure 3 semaines, consacrées à la recherche en avalanche.
Pendant les 7 ans d’activité du chien, celui-ci est entrainé tous les jours. Il faut toutefois trouver un compromis entre efficacité de l’entrainement et aptitude du chien au départ, un appel pouvant arriver à n’importe quel moment.
Le matériel
Chaque secouriste a un équipement dédié. Il y a une chasuble haute visibilité qui comporte radio et casque d’écoute ainsi qu’un sac de secours individuel. Le Major Laurent explique que le principe du sac est de permettre à son porteur de se sécuriser lui-même mais aussi la victime et le médecin. Il est donc en permanence prêt avec de quoi intervenir dans tous types de milieux ou presque.
Concernant le matériel individuel il s’agit de matériel d’alpinisme pris sur étagère.
Le matériel collectif est quant à lui plus spécifique. Il y a tout d’abord du matériel dédié au secourisme comme on peut en trouver dans toutes les structures faisant du secours mais également des matériels comme des treuils, des traineaux, du déglaçant, des traineaux hélitreuillables souvent développés par le PGHM.