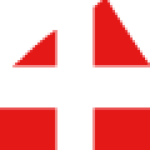Régulation des PFAS : une industrie française menacée ?

[[{"fid":"44456","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":309,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
Les délégués syndicaux FO de Tefal restent vigilants.
Depuis plusieurs mois, les régulations européennes visant à restreindre l’utilisation des PFAS, ces substances chimiques omniprésentes, suscitent de vives inquiétudes. Présentées comme une étape essentielle dans la lutte contre la pollution, ces mesures pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour l’industrie française et européenne. Parmi les entreprises concernées, Tefal, un fleuron de l’industrie française, est en première ligne. Avec plus de 1 300 emplois directs en jeu, sans compter les milliers d’emplois indirects, l’enjeu est immense.
Riad Boulassel et Georgia Bertrand, délégués syndicaux Force Ouvrière chez Tefal, nous ont accordé un entretien pour expliquer les défis auxquels leur entreprise fait face et les actions entreprises pour défendre à la fois l’emploi et une écologie raisonnée.
Pourquoi ces régulations européennes sur les PFAS suscitent-elles une telle mobilisation ?
Ce qui nous mobilise, c’est l’impact démesuré que ces régulations pourraient avoir sur notre entreprise et, plus largement, sur l’industrie française. Les PFAS sont des substances chimiques utilisées dans de nombreux secteurs, y compris les poêles antiadhésives que fabrique Tefal. Bien sûr, nous comprenons les préoccupations environnementales, mais interdire ces substances sans proposer de solutions viables mettrait directement en péril nos emplois et notre savoir-faire.
Vous parlez de menaces directes. À quoi ressemble concrètement cette menace pour Tefal ?
Si les interdictions prévues sont appliquées dès 2026, c’est simple : Tefal pourrait fermer. Cela représente 1 300 emplois directs, auxquels s’ajoutent 4 000 emplois indirects liés à nos activités dans le bassin économique local. Et ce n’est pas juste Tefal : c’est toute une chaîne industrielle qui risque de s’effondrer. Imaginez des milliers de familles impactées, des régions entières frappées par le chômage. C’est une catastrophe sociale en gestation.
Quels sont les arguments que vous avancez face à ces régulations ?
Nous voulons avant tout défendre un équilibre. L’écologie est essentielle, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l’emploi. Les PFAS sont utilisés dans des applications cruciales, comme les dispositifs médicaux pour les grands brûlés ou les prothèses. Les interdire sans alternative, c’est non seulement risquer des pertes économiques massives, mais aussi limiter l’accès à des technologies vitales pour la santé. Nous plaidons pour un calendrier réaliste, des investissements dans la recherche et des solutions transitoires.
Vous avez évoqué un déplacement à Bruxelles. Qu’avez-vous appris lors de vos échanges ?
Nous avons rencontré nos homologues européens et des représentants syndicaux pour comprendre comment d’autres pays vivent cette situation. Ce qui est clair, c’est que nous ne sommes pas seuls. Par exemple, en Bulgarie, où une région minière représente 40% de l’énergie du pays, ils subissent les mêmes pressions pour réduire leurs émissions. Ces échanges nous ont ouvert les yeux sur l’ampleur mondiale du problème et sur le manque de concertation au niveau européen.
Pensez-vous que le calendrier européen soit irréaliste ?
Absolument. L’échéance de 2026-2027 est trop courte. Même la commission européenne reconnaît qu’elle a sous-estimé la complexité de cette régulation. Les évaluations scientifiques prennent du retard, et les impacts sociaux et économiques sont mal mesurés. Nous demandons un report de l’échéance pour donner le temps à l’industrie de s’adapter et de développer des alternatives.
La loi visant à restreindre l’utilisation des PFAS doit être représentée en février prochain au parlement français. Comment percevez-vous cette échéance ?
Effectivement, la proposition de loi sera à nouveau débattue en février, et cela nous inquiète beaucoup. Nous avons déjà vécu une situation similaire l’année dernière, où la première version de cette loi avait été introduite sans réelle concertation ni prise en compte des impacts sociaux et économiques. Nous avons réussi à alerter certains députés à temps, ce qui a permis de suspendre le processus. Mais avec cette nouvelle présentation, le risque est que les mêmes erreurs soient reproduites. C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour contacter les parlementaires et leur présenter un argumentaire solide. Il ne s’agit pas de bloquer la loi à tout prix, mais d’en faire une base de travail pour trouver des solutions équilibrées.
Quels sont les efforts de Tefal pour répondre à ces enjeux environnementaux ?
Tefal a déjà pris des initiatives importantes. Par exemple, nous avons investi dans des filtres à charbon pour réduire les émissions de substances nocives. Nous faisons des efforts pour rendre nos produits plus respectueux de l’environnement, mais ces efforts ne sont pas mis en lumière. Les médias préfèrent montrer des images alarmistes qui ne reflètent pas la réalité de notre engagement.
Que répondez-vous à ceux qui accusent les entreprises de lobbying ?
Nous ne faisons pas de lobbying, et c’est une accusation qui, franchement, détourne l’attention des véritables enjeux. Nous défendons nos emplois et notre industrie, mais nous le faisons de manière transparente. C’est très différent des pratiques souvent associées au lobbying traditionnel. Ce que nous demandons, c’est un dialogue équitable. Nous voulons que nos élus, qu’ils soient français ou européens, comprennent l’impact réel de leurs décisions sur les travailleurs.
Ces accusations de lobbying semblent pourtant peser dans le débat public. Comment les percevez-vous au sein de l’entreprise ?
Ces accusations sont souvent brandies par des groupes ou des influenceurs qui veulent discréditer nos efforts. Mais quand on y regarde de plus près, certains de ces groupes ou individus agissent eux-mêmes pour des intérêts spécifiques. Prenez par exemple les influenceurs qui font la promotion de produits soi-disant «écolos». Souvent, ils travaillent pour des marques concurrentes basées à l’étranger, où les normes environnementales sont bien moins strictes que les nôtres en Europe. C’est un double discours qui finit par nuire à tout le monde. Et il faut aussi parler des effets pervers de ces campagnes médiatiques. Un reportage sensationnaliste ou un post sur les réseaux sociaux peut déclencher une véritable tempête. Les gens réagissent sur la base d’émotions, mais sans comprendre les conséquences concrètes.
Que proposez-vous pour contrer cette perception et recentrer le débat ?
La seule manière d’avancer, c’est par la transparence et le dialogue. Nous avons proposé à plusieurs reprises d’ouvrir nos portes pour montrer comment nous travaillons, quelles mesures nous prenons pour limiter notre empreinte écologique, et pourquoi il est important de réfléchir avant de tout interdire. Mais cette transparence doit être réciproque. Nous voulons que les décideurs politiques, les médias, et même les influenceurs se penchent sérieusement sur l’impact global de ces régulations. Et nous ne voulons pas seulement dénoncer, nous voulons construire des solutions. Nous proposons par exemple que les régulations s’accompagnent d’une vraie feuille de route pour la transition, avec des investissements publics et privés pour développer des alternatives aux PFAS.
Que pensez-vous des solutions mises en avant par certains groupes, comme l’utilisation de matériaux alternatifs ?
Ces solutions sont souvent présentées comme des panacées, mais elles ne tiennent pas toujours la route. Prenez l’exemple des ustensiles de cuisine en inox, qu’on nous propose comme une alternative. Ces produits coûtent bien plus cher que les solutions actuelles. Tout le monde n’a pas les moyens de dépenser plusieurs centaines d’euros pour une batterie de cuisine. Et en termes d’impact écologique, la production de ces alternatives n’est pas toujours meilleure. Ce qu’il faut, ce sont des solutions réellement adaptées, pas des slogans. Et c’est bien là le cœur du problème. En voulant aller trop vite, on pousse des solutions qui ne sont pas toujours viables à long terme. Ce n’est pas seulement une question de coûts pour les consommateurs, c’est aussi une question de faisabilité industrielle. Certaines alternatives ne sont pas encore au point, et vouloir les imposer trop vite, c’est risquer d’écraser les entreprises européennes au profit de leurs concurrentes hors UE.