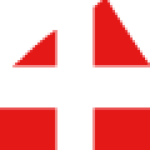Une blanchisserie pour toiles de chanvre et de lin – Albens 1818

Explorer les archives des XVIIIème et XIXème siècles procure bien des surprises En voici quelques-unes concernant des évènements ou des personnalités plus ou moins connues.
Les années qui suivirent le retour de la Maison de Savoie sous le règne de Victor-Emmanuel 1er, sont marquées par la reprise des affaires industrielles. Des entrepreneurs animés d’un fort esprit d’initiative créent un peu partout en Savoie des entreprises à l’image d’Antoine Saint-Martin qui, en 1818, ouvre à Albens une blanchisserie pour les toiles de chanvre et de lin. Blanchir le chanvre ou le lin nécessitait un travail long et continu que l’on observe bien sur un tableau du peintre Brueghel l’Ancien intitulé «Blanchissement sur pré». Le tableau nous renseigne sur la première étape du procédé que le «Dictionnaire français illustré des mots et des choses» présente ainsi «On blanchit les toiles de chanvre ou de lin en les étendant pendant plusieurs mois dans un pré pour les exposer à l’action de l’air, de la lumière et de la rosée».
[[{"fid":"37231","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":262,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
Une plante industrielle, le chanvre. (Gustave Heuzé, 1859)
Cette opération préliminaire a pour effet d’altérer la matière colorante contenue dans les fibres de chanvre afin de pouvoir la dissoudre ensuite à l’aide de lessives alcalines. C’est la seconde étape du processus qui requiert des bâtiments abritant les grandes cuves pour terminer le traitement. La lessive la plus efficace pour cette opération est celle à base de cendre de bois, de préférence de hêtre. On cherchait à obtenir une toile la plus «blanche» qu’il soit tout en sachant que l’obtention d’un blanc pur n’était pas possible. Pour effectuer toutes ces opérations longues et complexes, la blanchisserie d’Albens ne devait pas passer inaperçue dans le paysage albanais. C’est ce que nous confirme l’historien Casalis dans son «Dictionnaire» publié en 1833 où l’on peut lire «à peu de distance du bourg se trouve un lieu destiné au blanchissement des tissus : il est beau, spacieux et très renommé».
L’entreprise a dû être solide puisqu’en 1875, Victor Barbier, auteur de «La Savoie Industrielle» parle d’une blanchisserie qui «prospéra et qui subsiste encore». Il fallait certainement qu’elle soit adossée en amont à une culture du chanvre, à une production de fibre et à une activité de tissage bien implantées localement.
Conservé aux Archives départementales de Savoie, un livre de comptes apporte de précieuses informations sur la culture et le travail du chanvre dans l’Albanais. Dans celui-ci, Pierre Célestin Cochet, curé d’Albens de 1775 à 1793 tient soigneusement à jour le montant et la nature des dîmes perçues. A travers elles on a une idée des activités économiques locales, les paroissiens s’acquittant généralement en nature. Le chanvre qu’ils apportent au curé était cultivé dans de toutes petites parcelles. Une pratique agricole pour laquelle Victor Barbier précise : «Il est d’usage en Savoie, dans chaque exploitation agricole, d’avoir près de l’habitation un terrain peu étendu, auquel on donne le nom de chènevière, et où on sème annuellement du chanvre pour renouveler et entretenir le linge de famille». Selon plusieurs auteurs de l’époque, cette culture était très soignée dans la Vallée de Savoie, dans les environs de Rumilly et du Bas-Faucigny. En 1806, le préfet Verneilh rajoute : «les terrains…sont extrêmement favorables à la croissance de cette plante ; elle y obtient…une élévation commune de 2 à 3 mètres ; l’écorce en est très belle, et la filasse qui en résulte répond à cette beauté».
Avant que le chanvre puisse être filé et tissé, plusieurs opérations sont nécessaires, ainsi décrites par le préfet Verneilh : «On ne fait point rouir le chanvre dans l’eau, comme il se pratique à d’autres endroits ; on se borne à l’étendre pendant quelques jours sur la terre ou sur l’herbe ; le même procédé s’observe pour le lin. Les rosées et la pluie suffisent au rouissage de ces plantes filamenteuses, et les rendre propres à être teillées». Ce travail effectué, on obtenait des étoupes (fibres assez grossières) et de la filasse (fibres de meilleure qualité). C’est ce type de fibres que le curé Cochet donne à travailler à quelques femmes d’Albens : «donné en 1790 à filer dix livres de filasse à la femme de J-P Dubouchet et trois livres d’étoupes à la George ma servante». On sait aussi qu’il s’occupe de faire produire des toiles dont il fait livrer près de 40 mètres à Mme d’Orville pour la coquette somme de 160 sols.
[[{"fid":"37233","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":412,"width":260,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
Une fileuse et son rouet.
En cette fin de XVIIIème siècle, il existe bien une activité de filage et de tissage qui anime les campagnes et persistera tout au long du XIXème siècle. En 1875, Victor Barbier peut encore écrire à ce sujet : «Toutes les femmes de la campagne, ou à peu près, se livrent à ce travail… Il est acquis que la quantité filée par une femme ne dépasse pas 500 grammes par jour». Quant aux métiers à tisser, le même auteur précise : «Le canton de Rumilly en entretient de 70 à 75. On compte que chaque tisserand travaille en moyenne de 120 à 150 jours par an, et qu’il fait, à raison de 4 à 5 mètres de toile par jour, environ 600 mètres par année».
La culture de ces plantes industrielles (chanvre et lin), l’artisanat et les industries qu’elles entraînaient ne vont pas résister à la concurrence exercée par des espaces économiques plus dynamiques. L’arrivée d’une nouvelle méthode de blanchiment des toiles due à Berthollet (utilisation du chlorure de chaux), l’essor de la mécanisation vont porter un coup fatal à la blanchisserie dirigée en 1818 par Antoine Saint-Martin. La culture du chanvre régresse peu à peu dans les campagnes de l’Albanais remplacée après 1875 par une autre culture industrielle, le tabac.